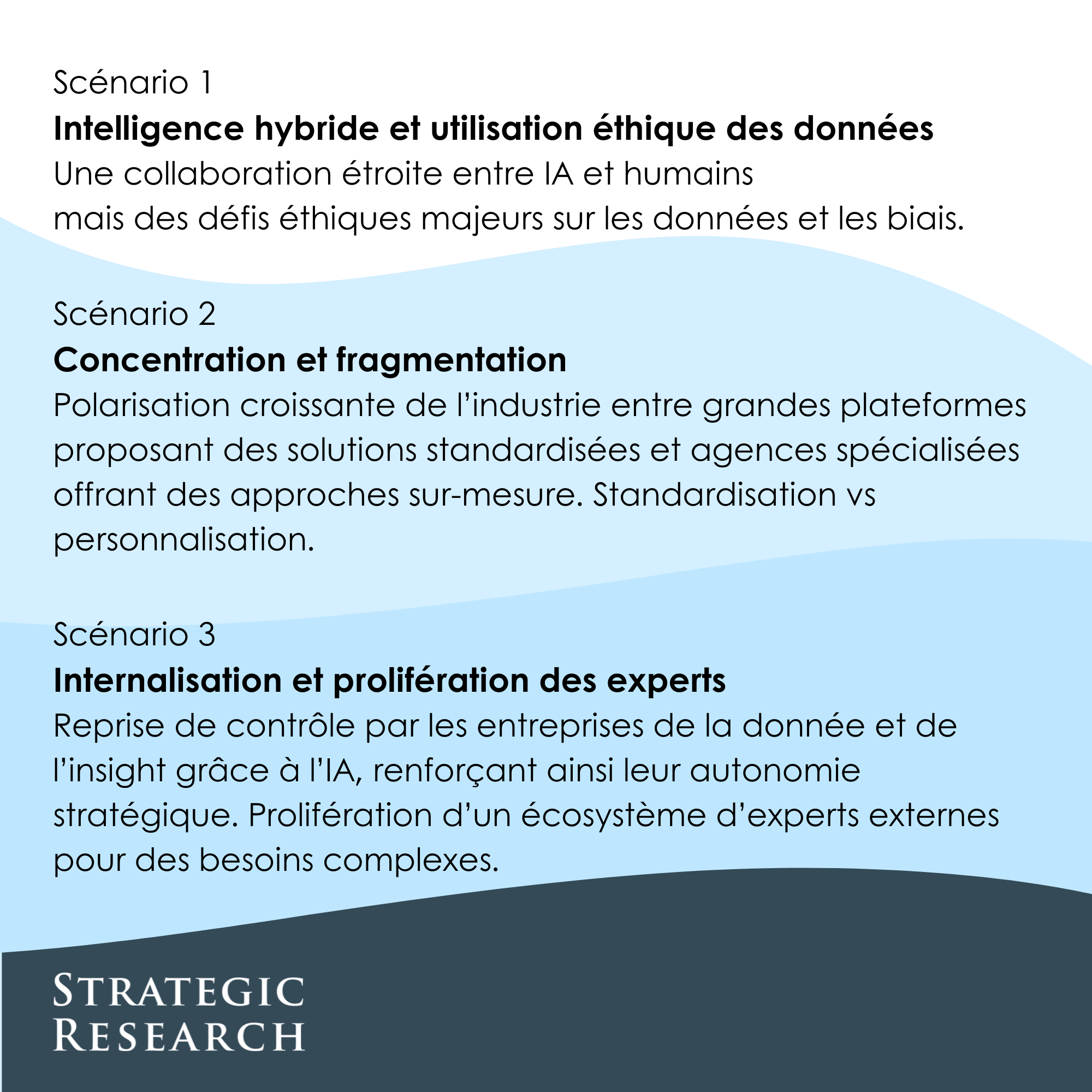Interview issue du dossier « Innovation : comment détecter le plus vite possible les meilleures idées ? (volet 1) » de Market Research News. Reproduite avec l’autorisation de Market Research News.
© Market Research News
 Diouldé Chartier-Beffa
Diouldé Chartier-Beffa
et Michael Bendavid
Associée fondatrice de D’Cap Research
Directeur Général de Strategic Research
Market research News : De votre point de vue, quel est le piège le plus important dans cet exercice d’identification des meilleures pistes d’innovation ?
Diouldé Chartier-Beffa et Michael Bendavid : Le terme de piège n’est peut-être pas celui qui convient le mieux, mais nous sommes convaincus de la relative inefficacité d’une démarche très répandue, y compris au sein de grands groupes comme Procter & Gamble, qui est celle des « gates ». L’idée générale est celle d’un processus de sélection. Pour faire son chemin, une idée doit passer par différentes étapes qui sont quasiment autant de go/no go, des sortes d’épreuves séquencées dans le temps. Ce type de système, hérité des années 70, n’a quasiment aucune chance de produire des innovations fortes puisqu’il est conçu pour réduire le risque à zéro.
Une autre démarche nous paraît plus efficace. Elle s’apparente plus à un processus de gestation, avec la mise en place d’un environnement, d’un « biotope » favorable à l’éclosion de nouvelles idées, en phase avec des besoins peu ou pas adressées par les offres présentes sur le marché.
En quoi consiste donc la méthode que vous préconisez ?
Il s’agit d’un cheminement général qui donne sa chance à des idées radicales d’émerger et d’être développées et présentées à la direction. Ce cheminement favorise la gestation et le dialogue. Des outils structurés aident à faire émerger, sélectionner et mettre dans une forme acceptable ces idées- avant que n’intervienne l’étape de décision du management.
Quelles sont donc ces étapes, en particulier dans la phase amont ?
Les étapes s’inscrivent dans un processus général de type groupe projet, qui rassemble les représentants des parties prenantes de l’entreprise, avec l’objectif d’élaborer des pistes d’innovation « franches » dans un temps relativement concentré. Par exemple deux ou trois mois. Ce groupe doit dans l’idéal intégrer le marketing et le commercial bien sûr, mais aussi la R&D, les services juridiques, les responsables des finances et du contrôle de gestion. Dès le démarrage des réflexions du groupe, il nous semble réellement essentiel qu’il y ait, avec ces différentes visions, une forme de consensus sur là où en est l’entreprise : comment innover si on n’est pas au clair sur ce que nous apportons au marché …
C’est la définition du positionnement stratégique de l’entreprise…
Oui. L’idée est bien celle exposée dans la démarche Océan Bleu : il s’agit de formuler les facteurs clés stratégiques du marché, mais vus du client. C’est la mise à plat des variables, des composantes sur lesquelles il est possible de jouer. Avant même de savoir dans quelle direction on peut faire évoluer l’entreprise et ses produits, il faut qu’il y ait une vision partagée quant à la définition de ces variables, et quant à la position relative de l’entreprise et de ses concurrents sur ces mêmes variables. La difficulté, c’est qu’il faut savoir regarder l’industrie de façon assez large, de façon à ne pas se focaliser sur les seuls concurrents directs. Si Coca Cola ne se définit que dans son face-à-face avec Pepsi-Cola, son champ d’innovation est très limité. Si l’entreprise veut réellement se mettre en position d’innover, elle doit avoir un regard plus large, qui intègre d’autres concurrents dans l’univers de la boisson et parfois même au-delà.
Est-ce si évident de savoir comment délimiter ce champ de concurrence ?
C’est bien le regard du consommateur qui permet de faire cela. La question est de savoir quels sont les autres produits qui pourraient se substituer à du Coca-Cola si l’on s’en tient à notre exemple. Ou plus largement quels sont les autres produits qui remplissent une fonction proche, et rentrent du coup dans ce champ de concurrence indirecte. Une question très simple donne parfois un éclairage efficace : par exemple, que fait le consommateur si le produit n’est pas disponible ? Consomme-t-il un Pepsi Cola ou bien un autre produit (par exemple un verre d’eau, un café, un bonbon) ?
L’idéal est d’aller plus loin, en ayant recours à des études qualitatives en profondeur pour recenser toutes les fonctions, tous les bénéfices associés à un produit ou un service donné, ces bénéfices pouvant être fonctionnels ou émotionnels.
Le canevas stratégique est donc posé, et on commence donc à identifier les alternatives possibles, en faisant bouger le curseur sur les variables clés…
Absolument. On fait bouger le curseur, ou bien on introduit une variable jusqu’ici absente dans le champ de concurrence directe. Pour nourrir cette recherche des alternatives, il est souvent très intéressant de raisonner sur le cycle d’expérience actuel du produit ou du service. On va regarder ce que l’on appelle les « douleurs» potentielles dans l’expérience des consommateurs (les « pain points » en anglais), mais aussi des non-consommateurs. On déroule l’ensemble de l’expérience du consommateur, depuis la recherche du produit jusqu’au moment où il se débarrasse de l’emballage, en passant par les phases d’achat, de livraison, d’usage, etcétéra. L’ouvrage de Kim & Mauborgne évoque le cas de cette marque de vin australienne, Yellow Tail, qui s’est intéressée au vécu des non consommateurs de vins. Elle est parvenue à innover fortement en travaillant sur les freins les plus manifestes pour les non-consommateurs, notamment sur tout ce qui est susceptible de créer des complexes pour des non-initiés au vin. Ce type de démarche est très efficace, parce qu’il permet de focaliser la recherche dans des directions fructueuses, plutôt que de procéder à une exploration tous azimuts.
Quels sont les protocoles d’études les plus efficaces pour identifier ces « douleurs » ?
Vous mettez le doigt sur un enjeu réel en termes d’études : pour que le consommateur verbalise, il faut à la fois qu’il dispose des mots nécessaires à cela, mais aussi qu’il soit complètement « en contexte ». Il est donc très intéressant de replonger le consommateur dans son environnement, et en contexte réel d’usage ou d’achat. C’est l’intérêt des approches d’ethnographie participante. On peut ainsi lui faire mettre des mots sur des expériences qui, précisément, se font d’habitude sans mots.
Dans beaucoup de domaines les conversations sur le web notamment les forums sont aussi une bonne source, car avec une procédure rigoureuse pour écarter les faux avis, on peut y recueillir un concentré de ces « douleurs » exprimées à chaud par des gens qui les vivent, et des solutions que les gens se donnent entre eux pour les résoudre.
Toujours dans ce même principe d’explorer dans les bonnes directions, voyez-vous d’autres démarches pertinentes ?
Il y a un principe bien connu qui consiste à se tourner vers le futur et donc à examiner les tendances. Il faut procéder à une identification des tendances qui sont à la fois lourdes, et susceptibles d’avoir des impacts importants et concrets sur l’industrie en question. S’en tenir à deux ou trois grandes tendances pertinentes est déjà un excellent gage d’efficacité. S’intéresser à la chaine de prescription est également une démarche intéressante pour identifier les pistes d’innovation sur une catégorie de produits ou de services : le marketing se concentre souvent sur l’acheteur final et oublie les prescripteurs qui sont un levier très puissant sur certains marchés. Il y souvent aussi un réel intérêt à s’intéresser aux best practices que l’on peut trouver dans d’autres industries, sur des problématiques comparables.
Vous auriez un exemple sur ce point ?
Nous avons le cas d’un client qui s’est posé la question de savoir comment revaloriser l’apport du conseil dans la vente de produits en pharmacie. Cela nous a emmené à étudier ce qui se pratiquait dans d’autres secteurs, et en particulier dans l’univers de l’optique. D’un certain point de vue, cela n’a rien à voir avec la pharmacie, et pourtant cela a permis d’identifier des pistes très intéressantes au carrefour d’un conseil technique et d’une relation privilégiée.
A partir des angles que vous venez d’évoquer, toute cette démarche de recherche d’idées se fait dans le cadre de sessions de créativité, de workshop ?
C’est vrai que l’on parle de workshop comme si c’était une évidence, et il est vrai que l’on passe le plus souvent par ce type de sessions, d’une journée ou d’une demi-journée. Mais au-delà des modalités concrètes, il nous semble qu’il y a deux points majeurs à respecter. Le premier enjeu est de faire en sorte que les participants puissent s’approprier très vite la connaissance du marché et la vision des clients. Les participants réalisent eux-mêmes des interviews auprès de non clients ou d’experts- cela leur donne une connaissance de première main du sujet, augmente leur implication dans le projet et stimule leur créativité. L’autre aspect majeur tient à la diversité des personnes présentes au sein du groupe projet. Nous l’avons déjà évoqué, il faut la présence des différentes parties-prenantes de l’entreprise, de la R&D au juridique en passant par le financier. L’idée est de sortir de ce processus habituel ou l’idée est « tuée » par la R&D trois mois ou plus après qu’elle ait été émise par le marketing. C’est bien sûr du temps perdu. Il faut qu’il y ait des conflits, mais ceux-ci doivent se régler au plus près du moment où sont émises les idées. Le groupe projet apporte une solution élégante au fonctionnement en silo qui prévaut dans les grandes organisations et qui limite leur capacité à innover.
D’autres aspects vous paraissent intéressants à mettre en œuvre dans ce même principe de laisser leurs chances aux bonnes idées ?
C’est un point essentiel ; nombre d’échecs en matière d’innovation proviennent de ces « croche-pieds » qui sont en réalité des règlements de compte entre différentes entités de l’entreprise. Une autre idée va complètement dans ce sens : elle consiste à ne pas « exposer » les idées en dehors du groupe tant que celles-ci n’ont pas la maturité et la consistance nécessaire. On passe donc du temps à vérifier que l’idée a bien un impact sur les leviers stratégiques (ceux que nous avons évoqués précédemment), et à définir des réponses consistantes aux objections qui pourront se présenter par la suite, lorsque l’idée sera présentée en dehors du groupe. Mais il y aussi des aspects de forme. Pour qu’elle puisse se « défendre », il faut formaliser l’idée, avec un pitch bien travaillé. Tout cela rentre bien dans ce processus de gestation que nous avons évoqué en préambule. Il faut laisser à ces embryons prometteurs une réelle chance de se développer.
J’entends que cette démarche de gestation a l’avantage d’être plus rapide, plus efficiente. Mais arrive-t-on in fine aux mêmes types d’innovation ?
Notre expérience nous permet d’affirmer que ce type d’approche favorise la génération d’innovations radicales, à fort potentiel. Bien plus que la démarche des « gates », qui donnent régulièrement lieu à ce que nous appelons des « produits Frankenstein », qui portent en eux tous les stigmates des contradictions qu’il a fallu gérer. Prenons l’exemple d’un produit qui peine à maintenir son référencement en linéaire, lancé il y a quelques années par Coca-Cola : du Fanta Still, sans bulles et à l’extrait de Stevia. Sa promesse est une addition de messages qui répondent chacun à une objection particulière, mais quel est le besoin réel auquel répond le produit dans son entier ? Beaucoup de ces produits Frankenstein s’écroulent assez vite, à quelques pas du laboratoire dont ils sont sortis !
En somme, tout le bénéfice de notre démarche Océan Bleu appuyée sur une recherche d’insights profonde, c’est d’accoucher rapidement d’innovations à la fois viables et radicalement distinctives.
Interview issue du dossier « Innovation : comment détecter le plus vite possible les meilleures idées ? (volet 1) » de Market Research News. Reproduite avec l’autorisation de Market Research News.
© Market Research News